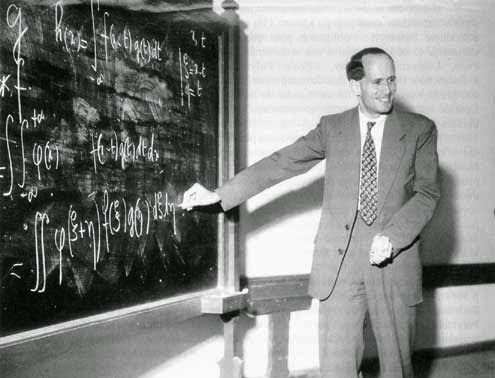Je viens de terminer la relecture, à presque quinze années d'intervalle, de l'autobiographie de Laurent Schwartz (1915 - 2002) intitulée « Un mathématicien aux prises avec le siècle », publiée en 1997 chez Odile Jacob. Ma première lecture datait de l'École d'été de Saint-Flour 1999 ! Ce grand livre de 528 pages est très riche sur les plans de l'histoire, de la science, et de la politique. Voilà donc un grand scientifique plutôt intellectuel, passionné, et passionnant. Mais le livre ne dit pas si ce libre penseur était facile à vivre. Table des matières :
AVANT-PROPOS ..........................9 INTRODUCTION. Le jardin d’Éden .......11 PREMIÈRE PARTIE ANNÉES DE JEUNESSE CHAPITRE I. La révélation des mathématiques ..41 CHAPITRE II. Normalien et amoureux ...........71 CHAPITRE III. Trotskiste .....................99 CHAPITRE IV. Un chercheur dans la guerre ....137 CHAPITRE V. La guerre aux Juifs .............189 DEUXIÈME PARTIE AU SOLEIL DE LA SCIENCE CHAPITRE VI. L'invention des distributions ........223 CHAPITRE VII. Militer, enseigner, chercher ........267 CHAPITRE VIII. Une reconnaissance internationale ..309 CHAPITRE IX. La réforme de l'École polytechnique ..333 TROISIÈME PARTIE AU CŒUR DU COMBAT POLITIQUE CHAPITRE X. L'engagement algérien ...................371 CHAPITRE XI. Pour un Viêt-nam indépendant ...........421 CHAPITRE XII. La lointaine guerre afghane ...........483 CHAPITRE XIII. Le Comité des mathématiciens .........497
Entre autres combats, Laurent Schwartz défendait que l'enseignement supérieur français avait besoin d'une profonde refonte, rapprochant recherche et élitisme : mettre de la recherche dans les grandes écoles et de la sélection à l'Université. S'il n'a pas été écouté pour l'Université, on peut dire, avec le recul, que son œuvre à l'École Polytechnique (1959 - 1980) a plutôt réussi, malgré ce qu'il en dit. L'X d'aujourd'hui lui doit beaucoup. Il avait même souhaité, à l'époque, un projet comparable à ce qu'est aujourd'hui Universtité Paris-Saclay. Extraits :
Sur la réforme de l'École Polytechnique (pages 353 , 354, 357, 358)
Mon ambition première avait été de donner à l'École polytechnique les moyens de former des ingénieurs de haut niveau capables de renforcer l'industrie française. Dans ce domaine, on peut parler d'un demi-échec. En 1980, lorsque je pris ma retraite, la formation des ingénieurs de l'industrie française connaissait encore un retard, car les mêmes pratiques nuisibles sévissaient dans toutes les grandes écoles, mais en pire, car le niveau de la recherche et des professeurs n'y est en général pas comparable à celui de l'X. Les reçus obtenaient pratiquement toujours le diplôme. L'École polytechnique constituait le cas le plus caricatural. Les Mines, les Ponts et les Télécommunications présentaient des traits similaires mais moins prononcés. Seules les « petites grandes » écoles réussissaient mieux, car l'avenir de leurs élèves était moins assuré, et les industriels qui y recrutaient des ingénieurs se montraient plus exigeants quant à leur formation. C'était le prestige général fondé sur la tradition, sur la hiérarchie des écoles, qui primait. Je dénonçai encore le laxisme de l'École vis-à-vis des élèves lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de mon départ.
En tout cas, les défauts signalés ici constituent un cercle vicieux. L'industrie française ne s'intéresse pas assez aux qualités de recherche de ses ingénieurs, et même pas assez à la recherche ; trop peu d'entreprises ont un laboratoire de recherche ou un bureau d'étude, trop peu ont des relations avec l'Université. Si un ancien élève de grande école a fait une thèse, il entre dans l'industrie plus tard que ses camarades de promotion, et touche donc une rémunération plus faible puisqu'on ne tient pas compte de sa thèse. Il sera en fait pénalisé. Dans ces conditions, les élèves des grandes écoles ne souhaiteront pas faire de recherche. L'industrie empêche donc bien l'École de former des chercheurs. Inversement, l'École, ainsi conditionnée, n'enverra pas de bons esprits chercheurs dans l'industrie, et celle-ci ne s'intéressera pas à la recherche ; l'École empêchera le développement d'une bonne recherche industrielle, et ainsi de suite. Entreprise-École, chacun renforcera la déficience de l'autre. C'est juste le contraire en Allemagne et aux États-Unis. J'ai participé sur ce sujet à une intense propagande, écrit des articles et des livres, organisé des conférences et des journées d'étude, etc. La situation a notablement changé en plusieurs décennies, mais pas encore assez. Un bon ingénieur doit savoir qu'il existe une recherche, des laboratoires d'industries et d'universités, un CNRS, des bibliothèques scientifiques et technologiques. Il doit avoir affronté dans sa jeunesse les difficultés de la recherche. Contrairement à la formation à la recherche qui prépare des futurs chercheurs et universitaires, la formation par la recherche est une recherche de début, qui ne sera pas suivie d'une carrière de recherche. On devrait repenser la formation dans les grandes écoles dans cette optique.
L'Université avait aussi ses problèmes. L'absence de sélection conduisait à une dégénérescence de plus en plus profonde, avant tout dans les premiers cycles. Beaucoup de mes articles et même de mes livres portent sur ce sujet, je ne le reprends donc pas ici. Je me trouvais donc en position de combat sur tous les fronts, mais n'ai pas été seul dans ce combat. Je crois avoir fondamentalement réussi à rénover le département et l'enseignement en ce qui concerne les mathématiques pures. Mais il y a aussi les mathématiques appliquées, dans lesquelles figurent les probabilités. J'ai déjà dit qu'à mon arrivée à l'École les probabilités étaient enseignées à un niveau très bas. Après de nombreuses péripéties, c'est Métivier, probabiliste éminent, qui fut nommé professeur de probabilités. Mais Métivier est mort prématurément d'un cancer. Il avait montré un courage exceptionnel, et sa perte fut très douloureuse pour tous. Jacques Neveu, probabiliste mondialement connu, lui succéda. Le groupe des probabilités a connu un grand développement, et cette branche des mathématiques, ignorée du temps de Paul Lévy, séduit à présent nombre d'élèves.
En ce qui concerne les mathématiques appliquées, qui se développent autour de l'analyse numérique, c'est l'arrivée de Jacques-Louis Lions à l'École qui a tout changé. Jacques-Louis Lions, on s'en souvient, avait été mon élève à Nancy en 1949 et fit sa thèse avec moi en 1954. C'était une thèse sur les équations aux dérivées partielles, pas encore vraiment sur les mathématiques appliquées.
...
J'avais quelques divergences avec Ésambert. Je trouvais souhaitable, à la fois du point de vue de l'École et de celui de l'Université, qu'un polytechnicien obtint au moins un diplôme universitaire. Aucune direction de l'École n'a jamais accepté cette idée, craignant, c'est évident, les comparaisons qui pourraient en découler. Des données intangibles auraient alors montré que les meilleurs élèves de l'École polytechnique étaient très au-dessus de ceux de l'université, mis à part les normaliens, et qu'environ le tiers d'entre eux n'atteignait pas le niveau inférieur des élèves moyens de l'université. J'ai moi-même eu l'occasion de vérifier ce fait, en proposant aux élèves d'une promotion une interrogation écrite que j'avais donnée en examen à l'université, pendant ma période cumulante. Le résultat confirma point par point ce que je viens de décrire. Les meilleurs élèves de l'École ont eu des notes très élevées, mais beaucoup ont eu des notes qui ne dépassaient pas 2 ou 3, équivalant aux résultats les plus bas des étudiants d'université. C'est évidemment scandaleux.
Comme Claude Allègre, lorsqu'il était conseiller spécial de Lionel Jospin au ministère de l'Éducation nationale, j'aurais souhaité que fût créée une université technologique de haut niveau dans le sud de Paris. Il n'existe en France qu'une seule université technologique, celle de Compiègne, l'UTC, fondée par Daniélou, dont j'ai moi-même fait l'évaluation pour le Comité national d'évaluation lorsque j'en étais président (1988). Son niveau, incontestablement bon, reste inférieur à celui des grandes universités. La formation des ingénieurs, en trois ans après un premier cycle d'université ou en cinq ans après le baccalauréat, y est toutefois excellente. Dans un sondage réalisé parmi les grandes industries à ce sujet, celles-ci l'avaient placée en tête. Mais l'UTC ne propose que des enseignements appliqués. C'était d'ailleurs ma conclusion comme celle de son directeur. Or ce qui est très intéressant dans les universités technologiques étrangères, celles des États-Unis dont je viens de donner deux exemples particulièrement remarquables, celles de Suisse et en particulier du Polytechnicum de Zurich, ou celles d'Allemagne, les Technische Hochschulen, c'est qu'à côté des départements d'ingénieurs elles possèdent des départements de sciences fondamentales du plus haut niveau. Je connais bien l'exemple du Polytechnicum de Zurich dont le département de mathématiques est célèbre. Heinz Hopf, un des principaux fondateurs de la topologie algébrique, mathématique abstraite s'il en fut, y enseigna longtemps, comme Eckmann, également topologiste algébriste de très haut niveau, et Chandrasekharan, qui travaillait en théorie analytique des nombres et s'installa en Suisse après avoir mené une large partie de sa carrière au Tata Institute of Fundamental Research de Bombay. On ne dédaigne pas les sciences les plus abstraites dans les universités technologiques étrangères, et tous les intermédiaires entre celles-ci et les sciences appliquées sont enseignés. L'École polytechnique, bien qu'elle donne le titre d'ingénieurs à ceux qui en sortent, est principalement une école de science fondamentale. Le département de mathématiques appliquées n'a lui-même rien à voir avec un département d'ingénierie. La plupart des autres sont en effet des écoles d'ingénieurs, mais le niveau de leurs départements fondamentaux est nettement moins élevé que celui de leurs départements d'ingénieurs, et il s'y fait peu de recherche fondamentale. Une université technologique regroupant, dans le sud de Paris, l'université d'Orsay, l'École polytechnique et l'École nationale supérieure d'électricité (Supélec) aurait pu entrer en compétition avec les meilleurs établissements de ce type à l'étranger. Ésambert n'a jamais voulu et je l'ai regretté.
Sur les classes préparatoires (pages 68 et 69)
Les taupes sont littéralement épuisantes. La plupart des élèves qui en sortent pour rejoindre les différentes écoles se sont tellement épuisés dans ces classes préparatoires qu'ils se reposent en première année. Le rendement des écoles s'en trouve d'autant diminué. Dans toutes les grandes et même dans beaucoup de petites écoles, certains élèves travailleront peu (voire pas du tout) pendant la totalité de leur scolarité et décrocheront néanmoins le diplôme, profitant du seul avantage d'avoir été reçus à l'entrée. C'est particulièrement flagrant à Polytechnique. Les universités d'Oxford et de Cambridge recrutent leurs jeunes à la sortie de la terminale. Elles opèrent une sélection en fonction de certains critères de valeur scientifique. Les élèves ainsi recrutés ne peuvent en aucun cas se permettre de ne plus travailler s'ils sont reçus à Oxford ou à Cambridge. D'abord, ils en seraient rapidement exclus. Si toutefois ils ne l'étaient pas, leurs connaissances ne dépasseraient pas celles du baccalauréat, et aucun industriel sérieux ne s'intéresserait à un étudiant sortant d'Oxford qui n'y aurait pas travaillé, alors que nos industriels ne craignent pas de recruter quelqu'un qui sort de Polytechnique, de lui confier un poste important, sachant qu'il a tout de même franchi l'obstacle de la taupe. Et tant pis s'il n'a plus travaillé après ! Nous formons donc des ingénieurs d'une valeur scientifique souvent faible.
Je ne voudrais en aucun cas qu'on supprime brutalement les taupes, car elles fonctionnent bien, ce qui n'est guère le cas du premier cycle universitaire. Cela reviendrait tout simplement à démolir le système. Mais je serais partisan d'introduire un certain nombre de modifications importantes. Il devrait exister plusieurs modes de recrutement des Écoles dont l'un reposerait sur le concours, comme c'est le cas aujourd'hui, tandis que d'autres différeraient. On pourrait imaginer qu'un examen du dossier scolaire accompagné d'un entretien ou tout autre type de modalité à étudier seraient susceptibles de drainer vers les Écoles d'excellents éléments. La diversité des recrutements est une nécessité vitale. Le physicien Alfred Kastler a fait une proposition à laquelle personne n'a jamais donné suite. L'École normale, disait-il, devrait proposer à tous ceux qui ont une nomination au concours général dans une des branches adaptées à l'ENS d'entrer tout de suite à l'École sans concours, et leur enseigner, non pas le programme tel qu'il est, mais un programme en cinq ans, analogue à celui du DEUG suivi des trois années actuelles d'École normale, entièrement dispensé par des professeurs d'université, comme c'est à présent le cas à l'École. Je sais que le concours général est loin d'être toujours significatif; il l'est cependant grosse modo en mathématiques et dans les branches littéraires ; il l'est nettement moins dans les sciences expérimentales, physique, chimie ou biologie, car il repose sur une épreuve écrite ou orale à caractère purement théorique. La proposition de Kastler serait donc à moduler. Ajoutons que les filles réussissent souvent mieux au concours d'entrée que les garçons dans les disciplines littéraires, mais peu ou pas du tout dans les disciplines scientifiques, où leurs résultats s'avèrent catastrophiques. D'autres classes que les taupes, et/ou d'autres méthodes de recrutement que le concours actuel leur permettraient sans doute de réaliser de bien meilleures performances. Toujours est-il que cette question du recrutement à partir des classes préparatoires et du concours d'entrée demande à être étudiée avec des idées entièrement nouvelles.
À méditer au vu de l'expérience de Paris-Dauphine ! Il est difficile de parler de l’université française en général. Pour les mathématiques, les laboratoires universitaires sont riches en universitaires qui ne sont pas issus de l’université, qui n’y mettent pas leurs enfants, et qui ne souhaitent pas que l’université change. Souvent de gauche, ils conçoivent l’université comme une œuvre sociale massive, qui ne doit pas faire d’élitisme. L'université pratique de fait une sélection par l'échec, qui fait perdre leur temps aux jeunes et ne valorise pas les diplômes. Parallèlement, les filières élitistes qui ont produit ces universitaires sont depuis longtemps trustées par les enfants de ceux qui en sont issus. Ce double phénomène illustre à merveille les thèses du sociologue Pierre Bourdieu sur la domination et la dialectique des élites. Le système actuel organise une séparation entre chercheurs en mathématiques, massivement à l’université, et bons élèves, massivement hors de l’université. Il y a beaucoup à dire sur la psychologie et la sociologie des universitaires. Pendant que certains déclarent qu’ils sont trop payés, d’autres pensent exactement le contraire et quittent la France ! Voilà donc toute une gauche universitaire, malade de ses symboles, qui organise depuis longtemps un immobilisme délétère. Malgré tout, certains établissements comme l’École Polytechnique et l’Université Paris-Dauphine font preuve de raison et d’audace. Ils tiennent lieu de laboratoires du futur pour un système à bout de souffle. La période est passionnante !
Note. Les extraits ont été obtenus en utilisant le logiciel de reconnaissance optique de caractères Tesseract sous Debian à partir de pages numérisées par un scanner avec Sane.
2 Comments